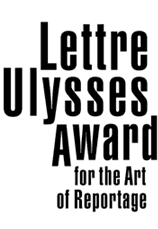
Lettre Ulysses Award Keynote Speech 2004 (French)
Abdelwahab Meddeb
Chemins de contrebande
Sur le chemin des contrebandiers, le pied trébuche, que de pierres et d’anfractuosités qui crèvent la terre battue, j’use d’un pas de danse pour éviter les flaques d’eau, sans interrompre la ligne de la marche, en file indienne, en silence, le chemin monte au contour du palais royal, soldats aux têtes sauvages, faces fermées surmontant des corps de haute stature, que je sens capables de se muer en brutes, troupe qui garde l’aire sacrée du prince, invisible derrière des murs qui coupent la falaise et ses éboulis de roches noires, mon regard se perd dans le miroir de l’eau, avant de se redresser et de courir sur les ondes dans la fosse du détroit, entre les deux mers, entre les deux continents, où les vents prennent source, et donnent au ciel une dramaturgie de guerre, fronts de nuages qui se font et se défont, qui se déplacent, se poursuivent, se superposent, s’entrechoquent, entament des courses qui les enfoncent dans le noir avant de les rendre à la blancheur, change perpétuel qui déroute le spectateur mais n’influe pas sur l’état du jour, tantôt voilé par une brume qui réduit l’espace à l’environnement immédiat, tantôt limpide, élargissant à l’infini le champ du visible, attirant à soi l’Europe, attrapée par l’aimant du cœur, offerte à portée de regard, de main, alors la traversée semble évidente, aisée, sans péril, pourtant chaque jour la radio annonce des morts, des cadavres rejetés par la mer, comme livrés à un dieu insatiable, qui réclame sa part de victimes, en instaurant un culte sacrificiel, dont les prêtres sont les passeurs qui se cachent dans l’ombre, comment les repérer, les reconnaître, parmi les passants que je rencontre lorsque je retrouve les rues qui montent et qui descendent au centre-ville, peut-être sont-ils les alliés des nuits sans lune, et en attendant les heures sombres propices à leurs méfaits, peut-être restent-ils tapis au fond des bars malfamés, glauques, aux portes entrouvertes, enfumés, dégageant les effluves du mauvais vin et d’une bière qui sent le détergent, places comme grottes qui contrastent avec la luminosité de l’extérieur que le vent décape, vent qui lave les yeux et frotte les nerfs, les aiguise, les met à vif, comme pour les rendre prompts à traquer les signes du mal qui ne cessent de se dérober à l’intuition, par contre les victimes du rite sacrificiel destinées à apaiser la fureur qu’engendre le croisement des deux mers, de telles victimes sont faciles à repérer au milieu de la foule où se reconnaissent nombreux les jeunes désorientés, affichant leur colère ou soumis à une résignation et une patience qui en un coup d’humeur se muent en révolte, eux qui rêvent d’un monde meilleur, le paradis est en face, regardez, il est à portée de bras et de jambe, seulement douze kilomètres, pour les franchir, il suffit de quelques coups d’aile décachetant les nuages, de quelques brassées ouvrant une mer étale, aussi plate qu’un miroir où se reflète le bleu du ciel, rêve d’enfant qui vous propose d’entrer dans un corps de mouette, de dauphin, pour que, en sept fois sept mouvements fendant l’air ou l’eau, les pieds parviennent à lever la poussière qui couvre la terre des délices, l’ordre du visible propose en effet un cruel mirage, qui se pare d’une beauté intrinsèque, ce vis-à-vis avec l’autre continent qui, parfois, vous saisit par surprise au détour d’une rue, dans l’axe inattendue d’une perspective s’offrant à l’œil après avoir avalé l’obstacle d’une voie qui monte, découvrant ébahi que la terre d’Europe circule dans les rues de Tanger, mais alors comment cette terre soumise au même climat s’avère-t-elle tant différente, pourquoi est-elle perçue comme celle dont témoignent les images d’un autre monde volées à la télévision, porteuses d’un rêve que tout actif se sent capable de réaliser, pourquoi ce lieu très proche conduit-il à un monde si lointain, pourquoi faut-il pour s’y conjoindre subir l’épreuve d’un rite initiatique où le candidat qui se propose risque sa vie, paradoxal paysage qui donne à respirer la mort et la beauté, cette lumière qui, par deux fois, a transformé la peinture, en 1832, avec Delacroix, en 1912, avec Matisse, éclaire aussi un théâtre de mort, scruté par plus de mille yeux avides, mobiles dans des cavités creusant le visage d’adolescents tournant le dos à leur pays, criblant de leurs prunelles la rive d’en face, suivant par temps de cristal les voitures se déplacer sur ce qui se devine tracé de route côtière, prolongeant la répartition des masses blanches de Tarifa, et il n’y a pas que les autochtones qui se proposent à un tel exil, je vois ceux qui viennent des profondeurs du continent, qui sont noirs, subsahariens, pas même francophones, se présentant à vous, dès que vous vous arrêtez à un feu rouge, les yeux incandescents, maigres, rongés par la faim, vous suppliant en un anglais approximatif de les nourrir, ne demandant pas même une aumône d’argent, prêt à vous suivre sans savoir où, pour avaler de quoi remplir leur panse vide, eux aussi payent leur part sacrificielle, de mes yeux j’ai vu un des leur en cadavre gonflé rejeté par la mer, sur la rive européenne, des bouts entiers de sa peau noire avait été rongés, laissant apparaître le rose fané d’une chair effilochée, déroutant les doigts vers un blanc d’os auquel s’accrochent des ligaments de nerf, et que deviennent-ils ceux qui se retrouvent ingambes sur les terres d’Andalousie, j’en ai croisé aux abords de Mojer, près de la Rabida, pas loin de l’estuaire qui abrite un complexe industriel, dans la proximité de Huelva, en cette sphère sanctifiée par l’histoire de Colomb, des trois caravelles qui avaient découvert l’Amérique, et qui ont été armées ici, et dont l’équipage venait des parages, aventuriers dont les descendants en rupture d’engendrement ont laissé la place vide, dans de petites agglomérations peu peuplées, dont les franges ont été abandonnées à ces rescapés du détroit, bandes noires disposées à prêter leur force vive pour les cueillettes et les travaux des champs, entre cultures maraîchères et entretiens de vastes vergers destinés à offrir à l’Europe la variété des fruits saisonniers qui mûrissent en ces bords extrêmes d’une Méditerranée déjà transformée par l’influence de l’Océan, bandes voyantes, isolées, conscientes de leur fragile nouveauté, non insérées dans le paysage, me demandant s’ils constituent un agglomérat de solidarité provisoire entre individus en rupture de ban, aventuriers de l’expatriation ou s’il s’agit de personnes assujetties à des réseaux les aliénant pour toujours à la désormais très lointaine communauté dans laquelle ils sont nés et ont grandi, et que deviennent sur cette même rive ceux parmi les Marocains qui réussissent à traverser sains et saufs le détroit, de nuit, sur des barques de fortune, ils quittent la ville en empruntant le chemin des contrebandiers, sur lequel je me suis trouvé promeneur en fin de jour avec une bande d’amis guidés par une artiste photographe qui a vécu une part de son enfance dans une maison au bord de la falaise située au commencement d’un tel chemin, femme qui, de chez elle, regarde tous les jours le détroit, familiarité qui l’a incité à se lier aux candidats à l’émigration clandestine, qu’elle a saisi dans leur désir d’Europe à Tanger et dont elle a retrouvé des survivants en mal d’adaptation à Marseille, investis par la haute violence de l’inarticulé qu’apporte la non-reproduction de soi par le langage et qu’elle a éveillé à l’introspection en les mettant en situation de représenter leur être en illustrant leur propre image adaptée au rapt de lumière qu’occasionne le déclic qui fixe la prise photographique dans la boîte noire, geste les autorisant à construire l’analogie du miracle christique qui les a sauvés de la noyade, comme s’ils avaient marché sur l’eau, ou à réinventer la stratégie des profondeurs, comme s’ils avaient traversé en sous-marin les abysses, porte de l’inconnu, de l’infranchissable monde des ténèbres, fin enveloppante et en expansion, corridor que les Anciens pensaient qu’il était soutenu par des colonnes gardées par le colosse Hercule, quelle horreur faut-il vivre, quel désespoir intérioriser pour vous engager à quitter le lieu où le hasard vous fit naître au risque de vous perdre, comme si vous aviez fui un front de guerre, déserteur en mal de traîtrise, creusant en vous une insondable béance que des séditieux habiles peuvent combler par le projet du terrorisme sacrificiel, ainsi tel corps rescapé n’aurait eu qu’à différer son sacrifice, en attendant sa réorientation, de la pure perte de qui se noie pour son seul compte sous les vagues et dans les courants où fermentent à leur rencontre les deux mers, vers le conditionnement fanatique du crime commis au nom de la foi, quelle est cette calamité qui incite le sujet à tout quitter, puis-je l’imaginer, l’identifier lorsque je marche dans Tanger et sur les contrées de l’arrière-pays qui prolonge la cité, lorsque je parle avec ses gens, lorsque je juge ses contradictions, ses paradoxes, ses apories, sa hiérarchie, ses riches, leur orgueil, leur arrogance, leur inhumanité, ses pauvres, ses laissés-pour-compte, ses jetés, ses méprisés, ses mendiants, ses prostituées, ses travestis au masque fardé, ses serviteurs obséquieux ou dignes, les maîtres de ses hauteurs, les rongeurs de ses bas-fonds, ses coprophages, nécrophages, ses flics véreux ou féroces, ses indics insidieux, ses imams aux prêches véhéments, que crachent des hauts-parleurs qui agressent les sens, ses noces tapageuses aux trompes qui à l’aube empêchent le sommeil, sa canaille, ses trafiquants qui font bâtir des villas toc laissées inhabitées, ses dealers, les signes patents du blanchiment par lequel s’infiltre l’argent sale qui s’incarne en immeubles de rapport exhibant leurs matériaux clinquants, que le dysfonctionnement d’une société soit visible à l’œil nu n’ajoute rien au drame, ne justifie pas le tragique d’une situation, face aux fléaux du Maroc, je convoquerai la détresse de l’Inde, je rappellerai le désastre de l’Egypte, j’évoquerai la circulation des figures érodées par la misère dans le paysage urbain outre-atlantique, le dénuement constitue-t-il une raison à la désertion, à l’appel du péril qui vous conduit sinon à vous dessaisir de votre vie, du moins à écorner une identité déjà ébréchée, et ce qui devrait configurer une frontière infranchissable entre les deux continents est en vérité une frontière des mieux fréquentées, des plus reconnues, des plus ouvertes, séparant deux Etats légitimes, respectables, en paix, pouvant selon les aléas de la conjoncture politique affiner leur alliance, frontière traversée par un flux continu de voyageurs, au rythme d’un ferry par heure, sinon plus aux mois de l’été où l’affluence des voitures se compte par dizaines de milliers, celle des cars et des camions par mille et cent, transportant les millions de Marocains vivant en de multiples régions d’Europe, dont bon nombre a acquis la citoyenneté de l’un ou l’autre de leur pays d’accueil, en conformité avec le droit du sol qui presque partout dans le vieux continent s’est substitué au droit du sang, au retour des originaires du Maroc s’ajoute une foule de visiteurs européens, sans négliger ceux qui suivent le sillage de la population impliquée par la mixité hispano-marocaine, qui forme un monde en soi, où est authentifié l’un des éléments constitutifs de la ville, dans l’entretien de son suspens multicolore entre ciel, terre et mer, in fine s’instaure la question de l’infranchissable frontière, de la barrière bien-gardée, dans le supplément et le reste où se condensent les problèmes irrésolus, d’abord ceux de la société marocaine, comme entité africaine, sous-développée, corrompue, touchée par la crise que traverse l’islam, ensuite ceux de l’Espagne, qui a quitté le sous-développement il y a à peine quarante ans, qui a parachevé sa modernisation à l’aide des subsides européens seulement au cours des deux dernières décennies, et qui continue d’œuvrer à « désafricaniser » son héritage spirituel (l’expression qui est de Miguel de Unamuno ne cesse de hanter les consciences) en refoulant la féconde part juive et arabe de son histoire, problèmes de l’Europe enfin qui n’en finit pas de s’interroger sur la stratégie à adopter face aux pressions du sud instaurées par l’opposition entre richesse et pauvreté, intensifiées par deux tendances démographiques inversées et objectivement complémentaires, le tout étant exacerbé par l’hétérogénéité des référents identitaires (quelle place accorder à l’islam par égard aux constituants gréco-judéo-chrétiens du site archéologique sur lequel s’élèvent les vestiges de la civilisation européenne ?), sinon des raisons de vivre à Tanger, il n’en manque pas, je n’évoquerai pas la seule quête esthétique qui fut celle qui attira Delacroix, lequel découvrit l’antique alors qu’il pensait rejoindre l’orient, remarque qui énonce cette part d’ancienneté demeurant vive, malgré les transformations dues à la diffusion universelle de la technique, quelque chose résiste, je suis à mon tour sensible à ce qui reste de cet aristocratisme qui rehausse les humbles, souci de soi qui a fasciné Delacroix, dans le geste et le costume de tel cordonnier, de tel muletier, il reconnaissait l’ampleur et la magnificence d’un Caton, d’un César, et les protagonistes de sa Noce juive, je découvre leurs descendants parmi les musiciens qui se rencontrent les dimanches juste avant la prière du couchant dans un café andalou du quartier al-Marshân, pas loin de la médina, si près du rivage, une véritable académie informelle perpétue la tradition classique léguée par l’Espagne musulmane dans la rigueur de l’instrument et la variation de la voix, de même la masse sonore qui module les vaticinations des Convulsionnaires de Tanger (eux aussi peints par Delacroix) continuent de déborder l’espace de la zawiya, couvent vers lequel converge le cortège transi des Aïssawa, de multiples formes d’expression qui nourrissent l’ancien sont encore vives, elles cohabitent avec d’autres formes qui marquent d’autres gens de Tanger ayant adopté en leur tréfonds le temps qui gouverne l’imaginaire, le symbolique, les techniques de la performance et de la représentation à la fine pointe de l’actuel, c’est cette cohabitation plurielle du temps qui donne sa densité à la ville, dans la variété de ses étages et de ses types, malgré les métamorphoses que telle agglomération a connues, je jouis de l’ombre que provoquent les travées tournantes de la mosquée bâtie intra-muros au XVIIe siècle par Moulay Ismaël, je déchiffre la calligraphie monumentale qui pare de ses amples cursives la corniche en cèdre du portail, lettres peintes qui révèlent la restauration commandée par Moulay Hassan à la fin du XIXe siècle, nuances coloriées qui entrent en résonance avec les carreaux de céramique lustrée livrant son rythme au minaret, dont le profil se projette sur la plate-forme latérale, qu’il me plaît d’assimiler à un narthex offrant aux catéchumènes une échappée vers le port, et dans la rue Ben Abbou, au cœur de la Casbah, je perçois le contraste fauve entre les teintes jaunes, vertes et mauves qui illuminent la coupole côtelée, à la base dentelée, du marabout Sidi Berraïsoul, telle qu’elle apparaît sur la toile peinte par Matisse, et c’est dans la partie touffue et sauvage aux contre-forts d’un jardin privé, dans la vieille montagne, accroché à la falaise que je retrouve la spontanéité, la fusée, l’élan, la flamme des acanthes, des pervenches, de la palme par lesquels Matisse honore le printemps dans ce que certains appellent le « Triptyque du jardin marocain », quelque chose d’autre résiste et perdure dans l’humanité peinte par Matisse, que d’échos à travers les traits et les costumes qui, dans le vif du présent, évoquent Zohra, la mulâtresse Fatmah, le Rifain, mais c’est au Café al-Hâfa, « le bord, le précipice, la falaise » que je retrouve le calme, la sérénité, l’extase, la simplicité du Café marocain, qui montre deux contemplatifs, l’un assis, l’autre couché restant des heures comme flottant, en lévitation, devant trois fleurs et deux poissons rouges, si marqués par le non-agir, si loin dans les méandres du fanâ’, processus qui conduit à l’effacement de soi, au point que les traits de leur visage sont absorbés par la teinte ocre, qu’on rattrape sur la calotte du crâne en contrepoint avec le blanc du turban, sur les mains et les tibias ou les mollets en contraste avec le gris perle des djellabas, duo au centre de l’espace accompagné à l’arrière-plan, sur la même plate-forme verte, de quatre musiciens et chanteurs, personnages de plus petite taille (seule concession à la perspective) se détachant avec la même palette trine (l’ocre de la peau, le blanc du turban, le gris de la djellaba) de la balustrade en forme de portique dont l’arcade et les colonnettes éclatent noires sur fond vert de gris, le peintre est sensible à l’accès des humains à la sérénité et à l’extase par la force de l’humilité et de la patience dans une nature âpre, drue, ensauvageant la plus apprivoisée des fleurs, deux caractéristiques qui distinguent la rive sud de celle qui lui fait face, comme si la vérité d’un même climat avait à se scinder pour enregistrer les vérités relatives au continent et à l’interprétation spirituelle de la croyance qui informe les cœurs et libère les échappées de l’esprit, Afrique sauvage, soufisme d’un peuple extatique, voilà ce qui a conquis Matisse et qui réconcilie mon origine avec la part européenne qui me constitue, dans la nostalgie de la perte, et dans le désir de vivre le divers qui peuple notre monde, mais alors pourquoi ces mêmes vertus ne retiennent-elles pas ceux des autochtones qui sont habités par le désir d’Europe, désir déchiré entre la fascination et la répulsion, ambivalence où s’inscrit la fente qui peut conduire dans la mauvaise énergie du ressentiment jusqu’au crime, comme il en fut pour ceux qui commirent l’attentat du 11 mars à l’approche de la Gare d’Atosa à Madrid, presque tous viennent de Tanger, de quartiers petits-bourgeois que nous avons à peine exploré, d’autres quartiers périphériques qui mangent avec célérité les vergers, les jardins et les bois qui environnaient la ville, ou de bidonvilles, où l’on nous dit que les intégristes réussissent à conquérir les âmes en couvrant les besoins élémentaires d’une population démunie, et abandonnée à sa déroute, un ami expert de l’UNICEF, fidèle à son idéal communiste, m’assure qu’il suffit d’agir dans le même sens pour détourner cette frange miséreuse des sirènes intégristes, aussi est-il pour les intégristes l’homme à abattre, en raison de son action concurrente, sur leur terrain de recrutement, et selon une stratégie similaire, reste à diagnostiquer quel mal corrode le corps de cette société, mal dont je ne peux m’empêcher de percevoir le symptôme à travers la propagation du voile parmi les jeunes filles et les femmes, signe d’une maladie où je repère l’effet d’une servitude volontaire, qui empêche de voir le trésor sur lequel on est assis, pour ne convoiter que la promesse du trésor qui vous appelle à quitter ici pour aller ailleurs, et où vous êtes parvenu, vous constatez que le trésor est enfoui là-bas d’où vous êtes venu, et ce sera dans les jeux de l’aller et retour, dans l’acquis de la liberté qui vous fait passer indifféremment du palace au bouge, du château à la chaumière, c’est dans ce jeu et cet acquis que vous vous dessaisirez à jamais de l’apologue, ballotté entre ici et ailleurs, vous jouirez du savoir qui vous informe que le trésor n’est nulle part, savoir qui vous destine à errer dans les contrées, à circuler dans les dédales et les labyrinthes, à traverser les frontières, à nomadiser d’un continent l’autre, dans l’incessante découverte du divers et de l’hétérogène, en un univers que l’ère de la Technique veut soumettre à l’autorité d’un pouvoir unique dont vous perturberez l’uniformité par l’interrogation de l’étranger que suscite chacune de vos haltes, sur l’une ou l’autre rive, quelle que soit la demeure dont vous êtes l’hôte.
© Foundation Lettre International Award
